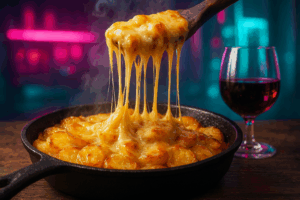Vous hésitez devant l’étal de votre fromager entre tomme et tome ? Cette question d’orthographe intrigue autant qu’elle divise les amateurs de fromage depuis des décennies.
Je vous explique tout sur cette subtilité linguistique qui cache une réalité fromagère plus complexe qu’il n’y paraît.
La réponse simple : les deux orthographes sont correctes
Le dictionnaire Larousse et le CNRTL reconnaissent officiellement les deux orthographes. Ces deux graphies désignent un fromage à pâte pressée non cuite de forme cylindrique fabriqué en montagne.
L’orthographe « tomme » avec deux M reste la plus fréquente. Cette version domine largement dans l’usage courant et concerne la grande majorité des fromages concernés.
L’orthographe « tome » avec un seul M constitue l’exception. Seuls quelques fromages spécifiques ont choisi cette variante pour se différencier volontairement.
Les deux termes partagent une étymologie commune. Le mot « toma » signifie en patois des Alpes le fromage fabriqué dans les alpages, confirmant leur origine montagnarde.
Attention à ne pas confondre avec le tome masculin. Ce mot désigne la division d’un ouvrage en plusieurs volumes et n’a aucun rapport avec le fromage.
L’histoire étymologique fascinante
L’étymologie de ces deux noms révèle une évolution linguistique plurielle. En 1671, « toume » désignait un fromage frais dans les écrits de l’époque.
En 1784, on trouve les premières tommes avec deux M. Ces mentions identifient différents fromages en Savoie, Dauphiné, Provence et Limousin dans les documents officiels.
En 1850, on nommait « tome » en patois franc-comtois un fromage d’hiver façon gruyère. Cette diversité régionale explique la coexistence des deux graphies.
À la fin du 19ème siècle, « toma » en occitan désignait un fromage frais caillé pressé. Le mot « touma » évoquait un fromage non pétri, mou, qui n’avait eu qu’une première façon.
Le cahier des charges de la tome des Bauges précise que le mot tome ou tomme aurait pour origine le terme « toma » en patois savoyard. Cette racine commune unifie toutes ces variantes.
Une des toutes premières attestations date de 1200 à Nîmes. Le mot « toma » désignait alors une jonchée, un fromage frais placé dans une claie de paille.
La différence géographique : une question de régions
L’usage des deux orthographes varie selon les territoires. On parle davantage de « tomme » dans les Alpes et en Savoie pour désigner des fromages affinés.
Le terme « tome » s’emploie principalement en Lozère et dans le Massif-Central. Cette préférence régionale remonte à des traditions linguistiques locales ancestrales.
En Savoie, le terme générique communément utilisé reste « tomme ». Il désigne les fromages en forme de disques et on dit qu’il en existe autant que de vallées savoyardes.
La tomme aurait ses origines dans les Alpes. La plus connue reste sans aucun doute la Tomme de Savoie qui respecte cette règle avec deux M.
La tome serait un fromage typiquement lozérien. Sa fabrication reste identique depuis de nombreuses années et perpétue une tradition spécifique.
Les caractéristiques distinctives supposées
Certains tentent d’établir des différences techniques entre les deux. La tome désignerait la tome fraîche de Cantal, un fromage non affiné utilisé dans l’aligot ou la truffade.
La pâte de la tome lozérienne présente des particularités. C’est un fromage dont la pâte ferme affiche de légères marbrures rougeâtres ou verdâtres caractéristiques.
En vieillissant, la pâte de la tome évolue. Elle passe du blanc jaunâtre à l’ivoire et peut même devenir un fromage à pâte fermentée après quelques mois.
La tomme affiche des couleurs plus tranchées. Sa pâte dure va du blanc au jaune sans marbrures et sa croûte présente un gris foncé à gris clair typique.
Ces différences restent très relatives et inconstantes. De nombreux fromages contredisent ces règles supposées, rendant toute généralisation hasardeuse.
Le cas emblématique de la Tome des Bauges
La Tome des Bauges AOP représente l’exception la plus célèbre. Ce fromage a délibérément choisi l’orthographe avec un seul M pour se démarquer.
Cette décision remonte aux années 1970. Quand le Beaufort obtient son AOC en 1968, les agriculteurs du massif des Bauges se trouvent à la limite de la zone retenue.
Ils fabriquent un gruyère de type Beaufort mais ne voient pas l’intérêt d’entrer dans l’appellation. Les fromages traditionnels se trouvent alors marginalisés et seules quelques familles maintiennent la fabrication.
Ce fromage domestique et familial nécessitait peu de lait. Il était encore considéré comme le « fromage du pauvre » contrairement aux grosses meules élaborées dans les fruitières.
Les producteurs s’organisent entre eux pour survivre. Ils créent une SICA en 1972 et déposent une marque « Tome des Bauges » avec cette orthographe distinctive.
L’orthographe avec un seul M existait dans certains documents anciens. Mais il s’agit surtout de différencier la production baujue des tommes produites dans l’ensemble de la Savoie.
Cette stratégie aboutit finalement à une AOC en 2002 puis une AOP en 2007. La Tome des Bauges devient ainsi le produit phare du massif grâce à cette différenciation.
Les autres exceptions notables
D’autres fromages ont également opté pour un seul M. La Tome de la Brigue, la Tome de la Vésubie, la Tome des neiges La Mémée et la Tome d’Arles suivent cette graphie.
La Tome de Lozère perpétue la tradition du Massif-Central. Ce fromage plus épais que les tommes savoyardes atteint 12 centimètres de hauteur.
La Tome de la Vésubie présente des dimensions respectables. Ce fromage de 30 à 35 centimètres de diamètre pèse entre 9 et 12 kilogrammes.
Ces exceptions confirment qu’aucune règle stricte ne gouverne l’orthographe. Le choix relève davantage d’une volonté de différenciation que d’une logique technique.
| Critère | Tomme (2 M) | Tome (1 M) |
|---|---|---|
| Fréquence | Très courante | Rare (exceptions) |
| Géographie dominante | Alpes, Savoie | Massif-Central, exceptions alpines |
| Exemple emblématique | Tomme de Savoie IGP | Tome des Bauges AOP |
| Dimension moyenne | Variable (100g à 10kg) | Variable (1,1 à 12kg) |
| Type d’utilisation | Fromage affiné à déguster | Fraîche (aligot) ou affinée |
| Motivation orthographique | Usage traditionnel | Différenciation marketing |
Les formes et tailles : pas de règle absolue
On pense spontanément à un fromage cylindrique quand on dit tomme. La Tomme de Savoie respecte cette forme avec environ 20 centimètres de diamètre.
On trouve aussi des petites tommes miniatures. La Tomme de Crest fait à peine 100 grammes pour 6 centimètres de diamètre.
Les très gros calibres existent également. La Tomme de Valdeblore pèse autour de 10 kilogrammes pour plus de 30 centimètres de diamètre.
Parmi les exceptions, la Tomme arlésienne se présente en carré. Cette forme inhabituelle de 6 centimètres de côté résulte du manque de place sur les étagères de séchage.
La tome fraîche utilisée pour l’aligot ou la truffade adopte une forme de bloc. Cette présentation pratique facilite la découpe et l’incorporation dans les recettes.
Les types de lait : une grande diversité
La tomme comme la tome peuvent être fabriquées avec différents laits. Le lait de vache reste le plus courant mais n’est pas exclusif.
Le lait de chèvre produit des tommes plus typées. Ces fromages développent cette note acidulée caractéristique qui séduit les amateurs.
Le lait de brebis apporte une richesse particulière. Ces tommes présentent une texture plus grasse et des saveurs plus rondes.
Les mélanges de laits créent des fromages uniques. On trouve des tomes mixtes brebis-chèvre typiques des montagnes d’Auvergne.
Indépendamment du terroir, la tome désigne un fromage fabriqué avec du lait d’animaux ayant profité de la belle saison. Ils ont pâturé en alpage pendant l’été pour produire ce lait d’exception.
Mes recommandations de fromager
N’hésitez pas à utiliser les deux orthographes. Aucune n’est incorrecte et votre fromager comprendra parfaitement votre demande dans tous les cas.
Privilégiez « tomme » avec deux M par défaut. Cette graphie majoritaire reste la plus sûre et correspond à la plupart des fromages concernés.
Respectez l’orthographe officielle pour les AOP. La Tome des Bauges s’écrit avec un seul M et mérite que l’on respecte ce choix identitaire.
Concentrez-vous sur la qualité plutôt que sur l’orthographe. Un bon fromage reste délicieux qu’il s’écrive avec un ou deux M.
La différence entre tomme et tome relève davantage du choix marketing que d’une réalité fromagère technique. Les deux orthographes désignent des fromages de montagne à pâte pressée, et seule la volonté de différenciation de certains producteurs explique la persistance de la graphie avec un seul M.