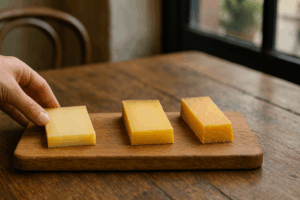« Comment fabrique-t-on une meule de Comté ? » – Voilà bien la question qui me passionne le plus ! Car derrière ces 40 kilos de fromage, il y a un processus fascinant qui transforme le lait cru en chef-d’œuvre. Et la première chose à savoir, c’est qu’il faut 450 litres de lait pour faire une seule meule. Oui, vous avez bien lu : presque un demi-mètre cube de lait pour un fromage !
Les chiffres qui donnent le vertige
450 litres de lait pour une meule de 40 kilos, ça signifie qu’il faut plus de 11 litres de lait pour obtenir 1 kilo de Comté. Ces chiffres expliquent déjà en partie pourquoi ce fromage coûte cher ! Quand on sait qu’une vache Montbéliarde produit environ 20 litres par jour en moyenne, une seule meule représente 22 jours de production d’une vache.
Dans ma région, je connais des producteurs qui me disent : « Une meule, c’est le travail d’une vache pendant trois semaines ». Ça remet les choses en perspective sur la valeur de ce qu’on a dans l’assiette !
La collecte : le défi de la fraîcheur
Tout commence par la collecte du lait dans les fermes. Le cahier des charges AOP impose que le lait soit transformé dans les 24 heures maximum après la traite. Pas de stockage prolongé, pas de transport sur de longues distances.
Dans le Jura, les fruitières collectent le lait deux fois par jour : le matin vers 7h pour le lait de la traite du soir, le soir vers 19h pour celui du matin. Cette fraîcheur est cruciale pour obtenir la qualité recherchée.

L’emprésurage : la magie de la coagulation
Arrivé à la fruitière, le lait est versé dans d’énormes cuves en cuivre de 4500 litres – exactement la contenance pour 10 meules ! Le fromager ajoute alors la présure naturelle et les ferments lactiques.
La présure fait cailler le lait en 30 à 45 minutes. C’est un moment magique : le liquide blanc devient une masse gélatineuse uniforme qu’on appelle le « caillé ». La température est maintenue à 32°C exactement – un degré de plus ou de moins change tout !
Le décaillage : l’art du fromager
Vient ensuite le décaillage, étape cruciale où le fromager découpe le caillé en petits grains de la taille d’un grain de blé. Il utilise pour ça un tranche-caillé, sorte de harpe géante avec des fils métalliques.
Cette découpe doit être parfaite : trop grosse, les grains retiennent trop d’humidité. Trop fine, ils perdent leur cohésion. C’est là qu’on reconnaît un bon fromager : à la régularité de son décaillage !

La cuisson : concentration des saveurs
Le caillé découpé est alors chauffé progressivement jusqu’à 55°C en brassant constamment. Cette cuisson dure environ 45 minutes. Elle expulse le petit-lait (qu’on appelle lactosérum) et concentre les protéines.
À ce stade, les grains de caillé ont la taille d’un grain de riz et une consistance ferme. Le fromager teste la cuisson en pressant une poignée de grains : ils doivent se souder légèrement sans s’écraser.
Le soutirage : séparation du bon grain
Une fois la cuisson terminée, le fromager laisse reposer 10 minutes. Les grains de caillé tombent au fond de la cuve. Avec une toile de lin, il rassemble alors toute cette masse au centre de la cuve.
Cette opération s’appelle le « soutirage ». Le fromager forme comme un gros paquet qu’il soulève délicatement. Imaginez : 40 kilos de caillé chaud et fragile qu’il faut manipuler sans casser les grains !
Le moulage : naissance de la meule
Le caillé est alors placé dans un moule en bois ou en plastique alimentaire, avec une toile de lin au fond. C’est à ce moment que naît vraiment la forme ronde caractéristique du Comté.
Une plaque d’identification est glissée entre le caillé et la toile : elle portera le numéro unique de la meule, sa date de fabrication, et l’identification du producteur. Traçabilité totale dès la naissance !
Le pressage : expulser la dernière humidité
La meule fraîche est mise sous presse pendant 12 à 24 heures. D’abord légèrement (pour ne pas casser la structure), puis avec une pression croissante jusqu’à 1 tonne !
Ce pressage expulse le petit-lait résiduel et soude définitivement les grains de caillé. À la fin, on obtient une meule compacte, lisse, qui sonne presque comme du bois quand on tape dessus.
Le salage : protection et goût
Démoulée, la meule passe au salage. Soit par immersion dans un bain de saumure pendant 12 à 48 heures, soit par salage à sec (on frotte la surface avec du gros sel).
Ce salage n’est pas juste pour le goût : il forme une croûte protectrice et régule l’humidité pendant l’affinage. Une meule mal salée risque de développer des défauts ou de mal vieillir.
Le petit-lait : pas de gaspillage !
Petite parenthèse sur le petit-lait : ces 400 litres expulsés pendant la fabrication ne sont pas perdus ! Dans les fruitières traditionnelles, ils servent à nourrir les cochons. Certains producteurs en font aussi de la ricotta ou le revendent aux agriculteurs comme complément alimentaire.
Rien ne se perd dans la fabrication du Comté : c’est cette philosophie anti-gaspi qui me plaît tant dans ce métier !
Le pré-affinage : premiers soins
La meule fraîche rejoint alors la cave de pré-affinage, maintenue à 12-14°C avec 90% d’humidité. Pendant les premiers mois, elle est retournée tous les 2-3 jours et frottée à l’eau salée.
C’est pendant cette période que se forme la croûte définitive et que commencent les premières transformations gustatives. La meule perd ses premiers kilos par évaporation.

Les ferments : les vrais artisans du goût
Tout au long de ce processus, les ferments lactiques travaillent. Ces micro-organismes transforment le lactose en acide lactique, développent les arômes, créent cette texture si particulière du Comté.
Chaque fruitière a sa flore microbienne spécifique, héritée de générations d’activité. C’est ce qui explique que deux Comtés du même âge puissent avoir des goûts légèrement différents !
Les contrôles qualité permanents
À chaque étape, des contrôles sont effectués. Acidité du lait, température de cuisson, durée de pressage… Tout est noté, tracé, vérifié. Un seul paramètre défaillant et c’est toute la meule qui peut être compromise.
J’ai vu des fromagers jeter une cuve entière parce que la température avait dérapé de 2 degrés. Cette intransigeance, c’est ce qui fait la réputation du Comté !
L’expertise du fromager
Fabriquer du Comté, c’est un métier d’expert. Le fromager doit adapter ses gestes selon la saison, la qualité du lait, l’humidité ambiante. Deux cuves identiques peuvent demander des traitements différents.
Cette expertise se transmet de génération en génération. Dans ma région, on dit qu’il faut 10 ans pour former un vrai fromager de Comté. Et encore, on apprend toute sa vie !
Les variations saisonnières
Le lait change selon les saisons, et la fabrication s’adapte. Le lait d’été, plus riche, demande parfois moins de chauffage. Le lait d’hiver, plus acide, nécessite des ajustements de ferments.
Ces variations naturelles expliquent pourquoi chaque Comté est unique, même en respectant scrupuleusement le processus. C’est la beauté de ce fromage : standardisé dans sa méthode, unique dans son résultat !
Ma fascination de fromager
Après 15 ans dans le métier, je reste émerveillé par cette alchimie. Transformer 450 litres de lait blanc en 40 kilos de Comté doré, c’est presque magique ! Chaque étape a son importance, chaque geste compte.
Et quand je vois une meule parfaite après 24 mois d’affinage, je repense à ce matin de fabrication, à ce fromager qui a su lire son lait, adapter ses gestes, créer les conditions du miracle.
C’est ça, la fabrication du Comté : un savant mélange de tradition millénaire, de science précise, et d’intuition artisanale. 450 litres de lait, quelques heures de travail expert, et des mois de patience pour aboutir à ce fromage d’exception qui fait la fierté de nos montagnes.
Alors la prochaine fois que vous dégusterez un morceau de Comté, pensez à ces chiffres fous : 11 litres de lait pour 100 grammes de fromage. Ça donne une autre dimension à chaque bouchée !